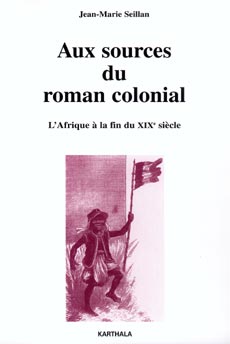 Vient
de paraître Jean-Marie Seillan Aux
sources du roman colonial
(1863-1914) L’Afrique
à la fin du XIXe
siècle Khartala, 2006,
509 pages, 30 euros. Les discours tenus aujourd’hui sur l’Afrique restent pour une large part pénétrés des fantasmes nourris par la conquête coloniale à la fin du XIXe siècle. Pour les saisir à leurs origines, l’auteur de ce livre est remonté aux sources du roman colonial français et a relu plus d’une centaine de romans ou cycles romanesques publiés entre 1863, date du texte fondateur Cinq semaines en ballon, et la guerre de 1914. Ces fictions, dues à quelques grands noms (Zola, Villiers de l’Isle-Adam, Jules Verne, Rosny aîné) et le plus souvent à une foule de feuilletonistes sans gloire (de Louis Boussenard à Fernand Hue, d’Armand Dubarry à Edgar Monteil), combinent avec une grande liberté les scénarios les plus improbables avec des matériaux empruntés aux récits de voyages des explorateurs. À ce titre, elles forment au sein de la littérature fin de siècle un vaste territoire inexploré, avec son histoire et ses sous-genres propres, ses pratiques d’écriture et ses stéréotypies particulières. Enfants perdus livrés à la gueule des lions, explorateurs assiégés par des hordes de cannibales, reines des Amazones à l’ardeur tropicale, sous-offs ignares proclamés rois par des foules noires émerveillées : rien ne manquait aux terreurs rassurantes et aux espérances illimitées promises aux lecteurs, ces téméraires aventuriers en chambre. Mais ces fictions leur livraient aussi, sous le couvert didactique et moralisateur d’aventures déclarées authentiques, des histoires de pillages et des scènes de carnages – affabulations de militaires rêvant, dans l’attente de la Revanche, de blanchir l’Afrique noire en exterminant ses habitants. De la
visite d’un continent alors si mal connu
qu’on pouvait tout en dire, il ressort que la France,
ligotée dans les certitudes rigides du positivisme, du
nationalisme et du racialisme, a rencontré
l’Afrique à la pire époque de son
histoire intellectuelle,
au point de faire d’elle le laboratoire fictionnel de ses
songeries
génocidaires, voire de ce qui apparaît
après coup comme un proto-fascisme
français. Jean-Marie Seillan a
enseigné dans les universités de
Tunis, d’Abidjan et de Niamey. Il est aujourd’hui
professeur de littérature
française du XIXe siècle
à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
et
directeur du Centre
Transdisciplinaire d’Épistémologie de
la Littérature. Intéressé par
l’œuvre
de Huysmans, la littérature et la presse fin de
siècle, il a publié diverses
études sur les écrivains naturalistes et
décadents. Table
des matières Introduction
générale
Antécédents littéraires Dominantes génériques Idéologie Typologie Première
partie
Les
Explorateurs
Introduction
Chapitre I. Jules Verne ou l’Afrique escamotée1. Où finit l’Afrique 2. Où finit le Blanc Chapitre II. Vénus noire et désir blanc1. Une intrigue de vaudeville 2. Une fantaisie exotique 3. Un discours didactique 4. Le théâtre du fantasme Chapitre III. L’Afrique des Origines1. Entre science et fiction : Louis Jacolliot au Pays des singes 2. Verne, la question des origines et le ‘chaînon manquant’ 3. Rosny aîné à la recherche des races perdues Deuxième
partie
Les Aventuriers
Introduction
Chapitre IV. Les Prédateurs1. Un continent dont on peut tout dire 2. Un continent où l’on peut tout faire Chapitre V. Les Profiteurs1. Les Chasseurs de trésors - Un coffre-fort géologique - Les aventuriers du tiroir-caisse - Du mythe à la réalité 2. La mauvaise conscience aventurière - Aristocratisme et embourgeoisement - Fortune et connaissance - Archaïsme et modernité Chapitre VI. Les Globe-trotters1. L’Afrique des casernes - Un sous-off autour du monde - Un perruquier sous l’Équateur 2. L’Afrique des enfants - Friquet et Friquette - Des Gosses autour du monde - L’Afrique à l’école 3. Un scénario inusable Troisième
partie
Les Politiques
Introduction Chapitre VII. Fiction et anticolonialisme1. Un conte philosophique : Le Navigateur sauvage 2. Entre la fable et la farce : La Sagesse de Koukourounou 3. Comique troupier et pantomime : Chapuzot au Dahomey Chapitre VIII. Les Romans de l’islamisme et du Djihad1. La politique de l’intolérance : Prisonniers marocains !, d’Hugues Le Roux 2. La politique de la concorde : Les Cavaliers de Lakhdar, de Fernand Hue 3. La politique de l’esquive : Les Exilés de la terre, d’André Laurie 4. La politique d’un viandard : L’Invasion noire, du capitaine Danrit - Amours coloniales - Un ‘technothriller’ 1900 - Colonialisme et proto-fascisme Chapitre IX. Les ratés de la conquête coloniale1. La fiction récrit l’histoire : l’humiliation de Fachoda - Paul d’Ivoi ou la victoire de la jactance - D’Hussonville au secours de Marchand - Les frères Lavarède contre l’Empire britannique - Pèlerinage à Fachoda 2. La fiction pense l’histoire coloniale : l’affaire Voulet-Chanoine - Les impostures de la fiction - Barsac ou le roman noir du colonialisme Quatrième
partie
Les
Fondateurs
Introduction Chapitre X. Quand le Blanc devient roi1. Pessimistes et cyniques - Les désillusions d’un (faux) humanisme - Les succès d’un vrai cynique 2. Les Bâtisseurs d’Empires - Colonialisme et coopération - Maternalisme, paternalisme, libéralisme 3. La Fin de l’aventure - La force aux prises avec le droit - L’âge des boutiquiers Chapitre XI. Progrès technique et utopies coloniales1. Une fantaisie ferroviaire 2. Verne et L’Invasion
de la
mer - Un roman d’ingénieur - La technique concurrencée par le mythe Chapitre XII. Colonialisme et natalisme : Zola au Soudan1. Tombouctou : mythe de la décadence et mythe des origines 2. Le Soudan zolien : exclusion et appropriation 3. Travail, Famille, Patrie Cinquième
partie
Pour une
topique du roman d’aventures coloniales
Introduction
Chapitre XIII. Science et magie1. Religion contre fétichisme 2. Science et illusionnisme 3. Le nouveau merveilleux occidental Chapitre XIV. Chasseurs et exterminateurs1. Chasses au gros gibier 2. Chasses à l’homme 3. Colonialisme et respect de la vie Chapitre XV. Esclaves et négriers1. Fictions progressistes et anti-esclavagisme 2. Apologies de l’esclavagisme 3. Tiko ou le roman de l’esclave Chapitre XVI. La Sauvagerie africaine1. Les sacrifices humains 2. L’anthropophagie 3. Cannibalisme et imaginaire décadent Conclusion Bibliographie Index des noms Table des matières
|
